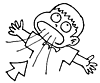
Ces praticiens ont appris, grâce à une étude menée sur l’ensemble du territoire national à l’initiative du professeur Denise Romette, que 72% des enfants de 11 à 13 ans souffraient de troubles de l’occlusion dentaire et de malformations dento-maxillaires consécutifs, pour la plus grande partie, à des perturbations des fonctions oro-faciales : ventilation, déglutition, phonation et posture linguale.
Quand les maxillaires n’ont pas eu un développement normal, ils ne peuvent pas recevoir en bon ordre les dents qu’ils devraient contenir et il est nécessaire, si on veut remédier au désordre dentaire, de sacrifier un certain nombre de dents définitives pour réaliser un alignement esthétiquement acceptable.
C’est la solution qui a longtemps été choisie quand les traitements orthodontiques étaient entrepris tardivement, c'est-à-dire après l’évolution des dents définitives vers la douzième année.
Cette solution qui apportait une solution esthétique au désordre dentaire, ne soignait pas la cause de ce désordre : le manque de développement maxillaire et la déviation des fonctions oro-faciales.
Pourtant les physiologistes avaient montré depuis de nombreuses années que le développement du maxillaire supérieur ne pouvait se produire que grâce à la ventilation nasale et que ce manque de développement était à l’origine de la plupart des troubles orthodontiques.
La prise en charge des troubles de la ventilation doit être précoce de manière à relancer la croissance faciale.
Pour comprendre comment se développe le maxillaire, il faut se remettre en mémoire un peu d’anatomie. Le maxillaire supérieur est un os ventilatoire avant d’être un os manducateur, porteur de dents. Le maxillaire est entièrement creusé de cavités pneumatiques : les fosses nasales et les sinus maxillaires, ce n’est que dans sa partie inférieure qu’il existe une base osseuse porteuse des dents.
D’autre part, le maxillaire supérieur est séparé de la base du crâne par deux éléments osseux, l’ethmoïde et le sinus sphénoïdal. En avant et au dessus du maxillaire, l’os frontal est aussi excavé d’un volumineux sinus.
Ce qui fait que toute la face moyenne est constituée, pour l’essentiel de son volume, de cavités contenant de l’aire est ces cavités débouchent toutes dans les fosses nasales.
Au moment de l’inspiration d’air par les fosses nasale, l’air contenu dans ces différentes cavités se mélange à l’air extérieur qu’il vient réchauffer et est remplacé dans ces cavités par de l’air frais.
Le premier avantage de cette ventilation nasale est que l’air inspiré est réchauffé par l’air de ces cavités pneumatiques, qu’il circule dans les fosses nasales en tourbillonnant grâce aux chicanes qui constituent les trois cornets (de chaque côté), qu’il est humidifié par son contact avec la muqueuse nasale et débarrassé de ses impuretés qui, piégées, par les cils vibratoires, restent prisonnières du mucus nasal. C'est-à-dire que l’air inspiré arrive sur les bronches et les poumons, réchauffé, humidifié et purifié, ce qui n’est pas le cas, bien au contraire, quand l’air est inspiré par la bouche.
| 1- Fosses nasales et cornets (supérieur, moyen, inférieur) 2- Orifice de la trompe d’Eustache (entrée de l’oreille) 3- Végétations 4- Langue 5- Bulbe olfactif 6- Sinus frontal 7- Sinus sphénoïdal 8- Voile du palais 9- Cordes du palais 10- Trachée 11 – Epiglotte 12- Œsophage |

Le second avantage de la ventilation nasale, est que l’air contenu dans ces cavités pneumatiques, qui se trouvent sous la base du crâne, est chargé des calories émises par le cerveau, qui sont ainsi évacuées, ce qui lui évite de monter en température.
Le cerveau, qui produit plus de calories que le muscle à poids égal, est un organe qui supporte très mal l’élévation de température.
Nous en avons tout fait l’expérience quand nous sommes « enrhumés du cerveau », nous perdons notre vigilance, n’avons pas les idées claires : en deux mots, nous nous sentons abrutis. Notre cerveau ne peut plus évacuer les calories qu’il produit par la ventilation nasale quand le nez est bouché : il monte en température et ses performances diminuent.
L’enfant qui respire par la bouche a constamment dans cet état de mauvais régulation thermique du cerveau et en subit les conséquences : baisse de la vigilance, mauvaises performances intellectuelles et fatigabilité accrue.
Enfin, il est remarqué que les respirateurs buccaux ont un sommeil agité et, qu’au matin, leur lit est complètement défait. Ceci vient du fait, qu’en raison de leur respiration buccale, ces enfant font des petites apnées du sommeil au cours de leur nuit ; leur respiration s’arrête un court instant, ils se réveillent à moitié sans s’en rendre compte, se retournent et froissent leur draps. Dans leur cycle du sommeil, ils n’arrivent pas au stade du « sommeil profond », et c’est justement, pendant le sommeil profond, que l’hormone de croissance est le plus sécrétée.
A tous les inconvénients associés à la ventilation buccale, vient donc s’ajouter celui d’un déficit de croissance, qui heureusement, chez le jeune enfant, se rattrapera dès que la ventilation nasale sera rétablie, à condition, bien entendu, qu’il persiste un potentiel de croissance, c'est-à-dire que l’intervention de rétablissement de cette ventilation soit précoce.
Le traitement orthodontique en agissant sur le maxillaire par l’intermédiaire des dents, va permettre de redonner à l’arcade dentaire et, par conséquent, au maxillaire qui la supporte une forme et une taille normales, entraînant de ce fait une augmentation du volume des fosses nasales. Cette augmentation va permettre immédiatement une meilleure perméabilité de fosses nasales, encore faut-il que l’enfant reprenne le chemin de la ventilation nasale et c’est là qu’intervient l’indispensable apprentissage de la ventilation nasale et le renforcement des éléments musculaires qu’elle nécessite.
Il faut « apprendre à respirer aux enfants » car le rétablissement d’une ventilation exclusivement nasale de jour comme de nuit est la vaccination contre la maladie orthodontique mais aussi parce que son retentissement sur la croissance et la santé physique et intellectuelle des enfants est considérable.


